La Salle Pierre-Mercure sera balayée par des Vents nordiques le 27 septembre prochain, à l’occasion du concert d’ouverture de la 55e saison de la SMCQ. Son directeur artistique Walter Boudreau a choisi de mettre à l’honneur la compositrice russe Galina Oustvolskaïa, méconnue du public d’ici; elle partagera l’affiche avec le Québécois Michel Longtin, dans un concert court présenté sans entracte. À quelques jours de cette ouverture, nous nous sommes entretenus avec le chef d’orchestre et professeur à l’Université de Montréal Jean-Michaël Lavoie.
Est-ce que cette rentrée pour la SMCQ est également une rentrée en salle pour vous?
En effet, ce sera mon premier concert post-pandémie. J’ai dirigé pour la dernière fois en février dernier. Je venais de rentrer de France et je m’apprêtais à y retourner en mars, mais mon concert a été annulé, comme tous ceux qui ont suivi. Je suis donc resté au Québec depuis ce temps-là.

Connaissiez-vous la musique de Galina Oustvolskaïa ?
Je connaissais plusieurs compositeurs russes de son époque, mais pas elle. J’ai découvert sa musique et l’importance qu’elle a pu avoir sur des gens comme Chostakovitch. C’est un exemple probant de ces compositrices qui n’ont pas eu les carrières qu’elles méritaient. Alors je suis content qu’on puisse découvrir cette musique-là aujourd’hui. C’est une musique foudroyante, avec une force solaire, sans hésitation. Si le mélange avec la musique de Michel Longtin paraît étonnante, on retrouve néanmoins d’un côté comme de l’autre beaucoup de force et de mouvement.
Les deux pièces d’Ustvolstkaia oscillent entre des notes nues et des clusters attaqués de manière très franche, sans beaucoup de nuance. Nous ne sommes pas dans la subtilité des timbres, mais dans des question de registre, d’épaisseur et de contraste. C’est une écriture claire et affirmée. Les huit contrebasses du Dies Irae offrent une sonorité que l’on retrouve très rarement. On pourrait penser que c’est massif, mais cela apporte au contraire un peu de chaleur à la pièce, contrastant avec le piano très fort ainsi que le cube.[1]
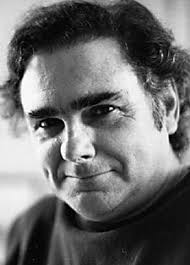
Vous allez également présenter lors de ce concert la pièce Pohjiatuuli de Michel Longtin, qui se veut un hommage à Sibelius. Est-ce que cet hommage transparaît dans la partition elle-même ?
Oui, Longtin lui-même le note dans les premières pages de sa partition. On retrouve tout au long de la pièce des emprunts plus ou moins cachés à plusieurs des symphonies de Sibelius. Il y a beaucoup de thèmes très dénudés également, très bruts, ce qui rappelle la musique du Finlandais.
Comment appréhendez-vous une partition comme celle-ci. Est-ce que l’aspect narratif joue un rôle dans votre interprétation musicale ?
Quand je découvre une partition, je pars de zéro. Je la prends à l’état brut, en essayant de comprendre la structure interne et de me l’approprier ainsi. Pohjiatuuli est une partition en plusieurs mouvements avec des sous-titres, elle se structure donc sous forme de tableaux. Dans mon travail de chef, j’ai besoin de me raconter une histoire, j’ai besoin d’images et d’exemples, mais cela arrive seulement à l’approche des répétitions. Car je ne veux pas superposer une vision à la partition.
Comment avez-vous vécu le temps du confinement, dans vos activités de chef et de professeur ?
J’avais beaucoup de projets comme chef qui sont tombés. L’emploi du temps de l’automne s’est vidé, et la partie professeur a pris davantage de place. En ce moment, les cours reprennent à l’université, où je dirige l’Ensemble de musique contemporaine. Cette saison, je n’ai pas prévu de concerts en grand ensemble. Mais j’ai su m’adapter aux changements en lançant un autre type de résidence pour les étudiants en composition. Il aurait été impossible de suivre le même cheminement qu’à l’habitude, à savoir d’attendre l’automne pour que les compositeurs suivent notre travail en répétition en vue d’une création à l’hiver. Aussi, nous avons décidé, de concert avec les professeurs de composition, de lancer les résidences pendant l’été pour que les projets puissent exploiter des collaborations à distance entre des interprètes et des compositeurs et que les pièces soient faites pour très petits effectifs. Celles-ci vont être enregistrées et donner lieu à un concert présenté en faux direct.
La pandémie a permis aux webdiffusions de se généraliser dans le domaine artistique, et le concert d’ouverture sera d’ailleurs retransmis sur le web. Pourquoi est-ce néanmoins nécessaire de continuer de faire des concerts en salle avec public?
Même si c’est une webdiffusion, le concert part d’une rencontre entre les musiciens et le public. Il faut voir la webdiffusion comme une extension du concert, dans le cas où des gens ne veulent ou ne peuvent pas se déplacer. C’est une option, mais cela ne doit pas remplacer le concert ou la performance. Il est essentiel que cette rencontre entre les musiciens et le public ait lieu. Par ailleurs, il faut noter que la webdiffusion est une belle ouverture pour la musique contemporaine, car la diffusion des concerts pourra atteindre davantage de personnes.
______
Vents nordiques sera présenté à la salle Pierre-Mercure le 27 septembre 2020 à 15h. Ensemble de la SMCQ, direction musicale : Jean-Michaël Lavoie. Présenté dans le cadre de la 55e saison de la Société de musique contemporaine du Québec. Directeur artistique : Walter Boudreau.
Voir également cette entrevue vidéo avec Walter Boudreau.
[1] La « femme au marteau » : Si la compositrice Galina Oustvolskaïa est méconnue du public, elle n’en est pas moins une figure importante de la musique russe du XXe siècle. Élève de Chostakovitch, elle va développer un style brut, radical, qui tranche avec son époque. On lui associe souvent des instrumentations inhabituelles, et les deux œuvres au programme du concert le confirment : Dona Nobis Pacem est un trio pour piccolo, tuba et piano, tandis que Dies Irae est une pièce pour piano, huit contrebasses et cube, une sorte de méga-tambour frappé par deux marteaux.
